Sciences humaines | Le 2 janvier 2025, par Raphaël Deuff. Temps de lecture : dix minutes.
« Langues de France et d'outre-mer »
Rromani
Langue vivante minoritaire non territoriale
Le rromani est une langue minoritaire non territoriale, de la famille des langues indo-européennes, possédant des locuteurs au sein des régions françaises. Elle est parlée en Europe et dans les deux Amériques, par la diaspora des Roms.
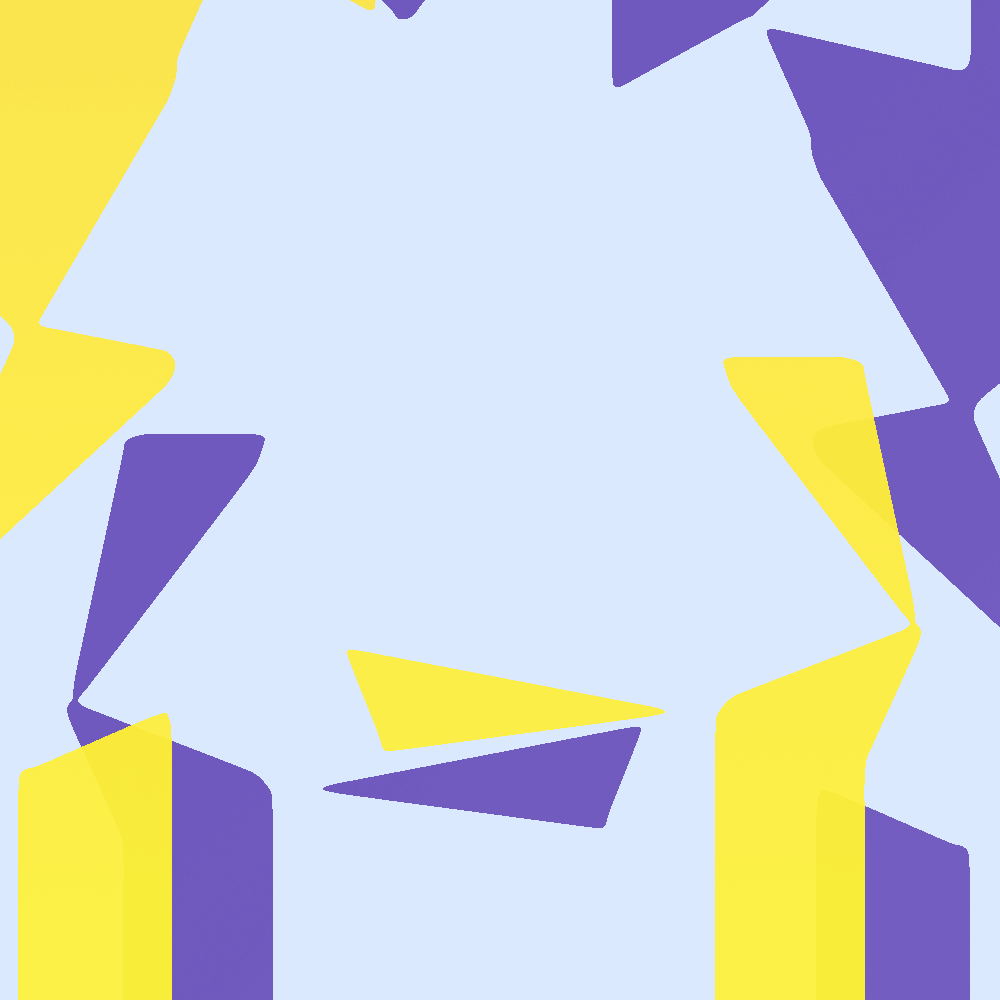
Le rromani, aussi appelé rromanès est une langue vivante régionale employée par une large diaspora en Europe et dans les Amériques du nord et du sud. Au sein des régions et territoires français, la langue est employée par 200 000 locuteurs approximativement, courants ou occasionnels. Dans le monde entier, le rromani compte approximativement six millions de locuteurs de nos jours. Elle est la langue du peuple Rom.
Linguistique
Selon la génétique linguistique, le rromani appartient au groupe des langues indo-aryennes, de la famille des langues indo-européennes. Historiquement, cette langue prend forme dans la région du nord de l’Inde, dans les environs de la ville de Kânauj selon les hypothèses les plus récentes. Les locuteurs rromani quittent leur région d’origine vers le xie siècle de notre ère.
La langue rromani est une langue SVO (syntaxe sujet-verbe-objet).
Littérature de la langue rromani
Le rromani est de tradition orale qui ne s’est dotée d’une littérature propre que très récemment, à la fin du xxe siècle, chez des écrivains d’Europe de l’est notamment.
Aujourd’hui, la langue rromani utilise l’alphabet latin à l’écrit.
La littérature sur la langue rromani connaît ses premiers linéaments au xvie siècle avec la publication de quelques brefs glossaires. Le premier est un manuscrit en latin remontant aux alentours de 1515 ; en 1547, le médecin gallois Andrew Borde (ca 1490-1549) publie quinze phrases en langue rromani. En 1577 un magistrat de Groningue, Johan von Ewsum, donne un glossaire rromani-vieux frison sous le titre de Clene gypta sprake, qui identifie le rromani comme une « langue égyptienne ». On doit aussi à l’humaniste flamand Bonaventura Vulcanius (1538-1614) un petit lexique rromani (assimilé là encore à de l’égyptien) qu’il doit à l’érudit français Joseph Juste Scaliger (1540-1609), et qui est présenté en appendice à son De literis et lingua Getarum sive Gothorum (1597) sous le titre « De nubianis erronibus » (Des erreurs des Nubiens). En 1755 enfin, paraît un anonyme Dictionnaire de la langue bohémienne, avec une lettre d’un Bohémien à sa femme (Wörterbuch von der Zigeuner-Sprache), comptant un petit millier de termes rromani du dialecte des Sintés, traduits en haut-allemand.
À la toute fin du xviiie siècle, l’écrivain Johann Christian Rüdiger (1751-1822) est le premier à entreprendre une véritable analyse linguistique (lexique et grammaire) qui démontrera l’hypothèse d’une origine indienne du rromani, dans un chapitre des Derniers développements de la linguistique teutonne, étrangère et générale (1782).
Le xixe siècle voit la publication par le linguiste franco-roumain Jean-Alexandre Vaillant (1804-1886) d’un ouvrage de Grammaire, dialogues et vocabulaire de la langue des Bohémiens ou Cigains (1868) ainsi que des Études sur les Tchinghianés, ou Bohémiens de l’Empire ottoman (1870), par l’érudit grec Aléxandros Paspátis (1814-1891).
Au xxe siècle, le linguiste Marcel Courthiade (1953-2021) est à l’origine de travaux majeurs et d’un enseignement en sociolinguiste rromani auprès de l’École pratique des hautes études (EPHE). Sa contribution dans l’ouvrage dirigé par Claude Hagège et István Fodor, « La langue romani (tsigane). Évolution, standardisation, unification, réforme » (La Réforme des langues, vol. IV, 1989), s’attache plus particulièrement aux enjeux liés à l’écriture du rromani dans la littérature contemporaine. Le linguiste Patrick Williams (1947-2021) est l’auteur d’un papier intitulé « Langue tsigane : le jeu romanès » (Geneviève Vermès, Vingt-cinq communautés linguistiques de la France, vol. I, 1988), qui aborde le jeu entre les communautés tsiganes et leur langue.
Parmi les premières publications d’une littérature orale de langue rromani, le folkloriste transylvain Heinrich von Wlislocki (1856-1907), dans Fleurs de haies. Chansons populaires des Tsiganes de Transylvanie (Haideblüten. Volkslieder der transsilvanischen Zigeuner, 1880) et Märchen und Sagen der Transsilvanischen Zigeuner (Contes et légendes des Tsiganes de Transylvanie, 1886) notamment, a recueilli à la fin du xixe siècle les éléments d’une mythologie et d’une culture tziganes alors particulièrement vives en Transylvanie.
Au xxe siècle, le linguiste d’origine polonaise Vania de Gila-Kochanowski (1920-2007) a traduit et publié plusieurs contes tsiganes balto-slaves (t. I : « Le Roi des Serpents », t. II : « La prière des loups », 1996). L’aumônier Joseph Valet (1927-2023) a également publié trois volumes de Contes manouches (1988-1994).
Enfin, parmi les auteurs de langue rromani aujourd’hui, on peut mentionner les œuvres des écrivains serbes Rajko Djurić, Jovan Nikolić, du Berlinois Ismet Jašarević, et de l’écrivain macédonien Šaban Iliaz.
Droit et institutions
Pour les régions de France, la Constitution de la Ve République dispose du français en tant que « langue de la République » (art. 2 modifié par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992), ce qui exclut l’existence de droits-créances pour l’emploi d’une langue autre que le français. L’utilisation de ces idiomes minoritaires n’est cependant pas proscrite dans la sphère publique, d’autant plus avec la reconnaissance de leur intérêt comme patrimoine immatériel par l’article 75-1 de la même Constitution introduit en 2008.
En France, en tant que langue régionale, ce sont le Code de l’éducation (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11), le Code rural (L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129) et le Code de la consommation (L. 121-33) qui disposent en France de l’enseignement de la langue romani. Dans le supérieur, le rromani dispose également d’un enseignement à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), ainsi qu’à l’université de Bucarest en Roumanie : il s’agit aujourd’hui des deux seuls établissements au monde tenant un enseignement universitaire dans la langue rromani.
L’utilisation des langues minoritaires dans la presse, les médias et dans la sphère publique est encadrée par la loi Toubon (loi sur l’emploi de la langue française).
Dans certains pays du continent européen, cette langue est également protégée au titre de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires (1992) : en Autriche, en Norvège, en République tchèque, en Roumanie et en Ukraine (II, art. 7), en Bosnie-Herzégovine, en Hongrie, au Monténégro, en Pologne, en Serbie et en Slovaquie (II, art. 7 et III, art. 8-13) ainsi qu’en Allemagne (II, art. 7 ou II, art. 7 et III, art. 8-13), en Finlande, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Suède (II, art. 7.5).
Parmi les organismes qui promeuvent aujourd’hui la langue rromani, sa pratique et son enseignement, se trouve le Commissariat à la langue et aux droits linguistiques de l’Union rromani internationale.
Raphaël Deuff
Notice synthétique
Noms français : rromani, rromanès
Nom anglais : Romani
Statut : langue vivante minoritaire non territoriale
Territoires d’implantation : nord de l’Inde
Système de transcription : alphabet latin (transcription)
Famille linguistique : langues indo-européennes
Typologie linguistique : SVO
Notices d’autorité et bibliographiques : roma1329 (Glottolog.org), rom (ISO 639-3). Parent : indo1322 (Glottolog.org)
Ressources et portails
Commissariat à la langue et aux droits linguistiques de l’Union rromani internationale : portails français (union-romani-internationale.blogg.org) et espagnol (unionromani.org)
Ressource : Romani – rom (iso639-3.sil.org)
Ressource : Romani – roma1329 (glottolog.org)
Ressource : Indo-Aryan Central zone – indo1322 (glottolog.org)
Ressource : Rromani (inalco.fr)
Ressource : OLAC resources in and about the Romany language (language-archives.org)
Ressources bibliographiques
Bernard Cerquiglini, Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 1er avril 1999. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Christos Clairis, Denis Costaouec et Jean-Baptiste Coyos (dir.), Langues et cultures régionales de France, Paris, L’Harmattan, 2000.
Henri Giordan (dir.), Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, Kimé, 1992. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Henri Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport présenté à Jack Lang, ministre de la Culture, Paris, La Documentation française, 1982. Notice en ligne (catalogue.bnf.fr).
Henri Giordan et al., « Les langues de France », Tribune internationale des langues vivantes, Paris, 2000.
Wolfgang Jenniges (éd.), Select Bibliography on minority languages in the European Union / Bibliographie sélective des langues minoritaires de l’Union européenne, Bruxelles, Bureau européen pour les langues moins répandues, 1997. Notice en ligne (europeansources.info).
Benoît Paumier et al., Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication, 17 juillet 2013. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Jean Sibille, Les Langues régionales, Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000.
Geneviève Vermès (dir.), Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (2 vol.), Paris, L’Harmattan, 1988. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Texte de référence : Constitution du 4 octobre 1958 (legifrance.gouv.fr), art. 2 et 75-1
Enseignement
Texte de référence : Code de l’éducation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11
Texte de référence : Code rural (legifrance.gouv.fr), art. L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129
Texte de référence : Code de la consommation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-33
Médias et sphère publique
Texte de référence : Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (legifrance.gouv.fr), dite « loi Toubon »
Entités nommées fréquentes : Europe, France, Code, II, Romani, Paris, Giordan, Union, Culture, Constitution.
L’actualité : derniers articles
Actualités culturelles
De Paris à la Corse et des Alpes au Québec : panorama des festivals littéraires d’avril 2025
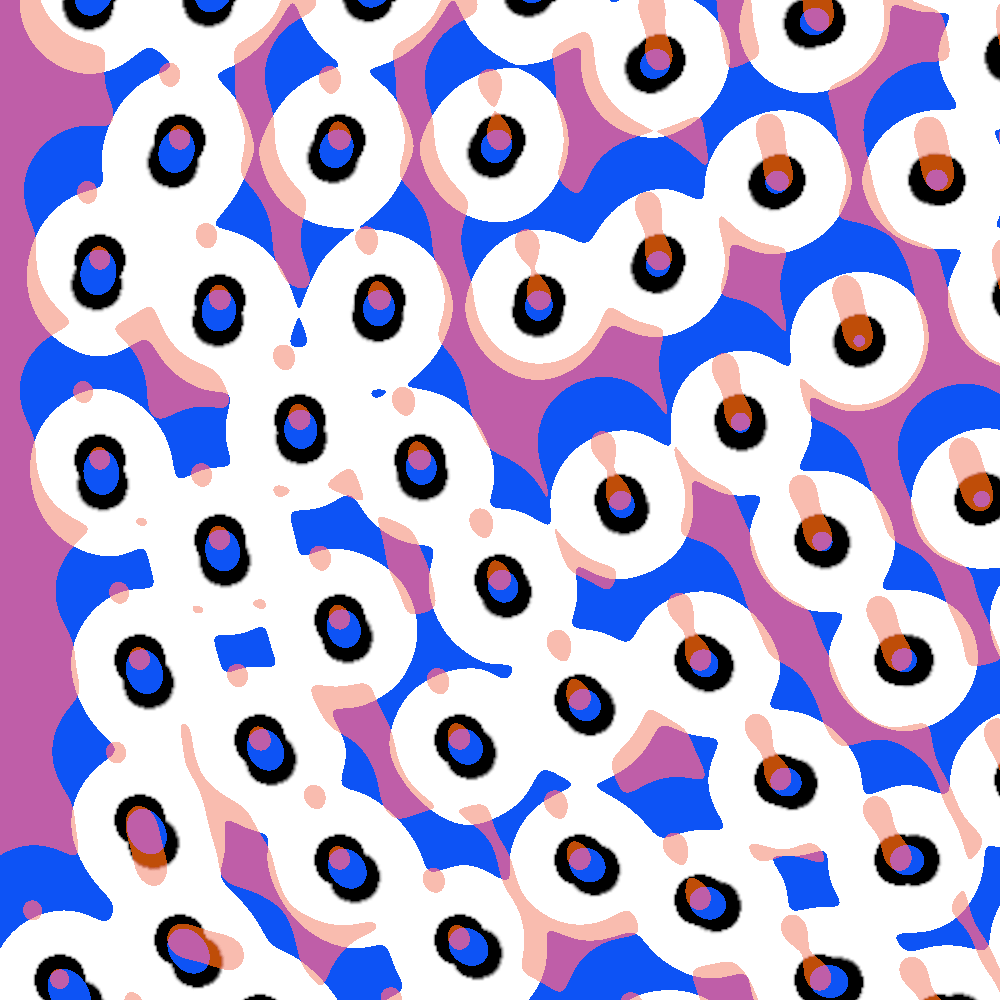
Technologie
Apprentissage statistique

Technologie | Le 3 avril 2025, par Raphaël Deuff.
Technologie
Données ouvertes : OpenAI annonce la publication partielle de l’architecture de son nouveau modèle d’IA

Technologie | Le 2 avril 2025, par Sambuc éditeur.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...