Sciences humaines | Le 3 janvier 2025, par Raphaël Deuff. Temps de lecture : huit minutes.
« Langues de France et d'outre-mer »
Judéo-espagnol
Langue vivante minoritaire non territoriale
Le judéo-espagnol est une langue vivante minoritaire non territoriale, qui appartient à la famille des langues indo-européennes. Elle est parlée dans les territoires français et ailleurs en Europe, dans le nord de l’Afrique (Maghreb) et au moyen-orient, au sein d’une partie de la diaspora juive séfarade.

Le judéo-espagnol, aussi appelé ladino est une langue vivante minoritaire employée en Europe et dans la diaspora juive séfarade. Au sein des régions de France, la langue connaît approximativement quelques milliers de locuteurs, courants ou occasionnels. Dans le monde entier, on compte aujourd’hui près de 130 000 locuteurs de la langue judéo-espagnole. Il s’agit de la langue traditionnelle des Juifs séfarades.
Typologies linguistiques
Dans la classification génétique des langues, le judéo-espagnol appartient au groupe des langues ibéro-romanes, au sein de la famille des langues indo-européennes. Son implantation d’origine se situe dans l’Espagne des royaumes de Castille et d’Aragon.
La langue judéo-espagnole est une langue SVO (ordre sujet-verbe-objet). Sur le plan de la rythmique, il s’agit d’une langue syllabique, soit rythmée par les syllabes.
Littérature du judéo-espagnol
Langue d’exil des Juifs espagnols à partir de la fin du xve siècle, le ladino est dès son origine l’objet d’une riche littérature, à la fois écrite et orale, sacrée comme profane.
Parmi les premières oeuvres écrites en judéo-espagnol, on notera, dans le domaine sacré, le Pentateuque de Constantinople (1547) et les Prophètes de Salonique (1572), et la somme encyclopédique du Me–Am Lo’ez (D’un peuple étranger, 1730), due au rabbin Jacob Culi (1689 ?-1732). La littérature profane s’illustre pour sa part dans les genres du romancero et du coplas (xvie siècle), du refranero et du contero (xviie siècle).
Encore active et largement renouvelée au cours du xixe siècle avec la presse, les traductions et l’apparition de genres nouveaux (roman, théâtre), la littérature judéo-espagnole est aujourd’hui menacée de disparition.
Aujourd’hui, l’écriture de la langue judéo-espagnole se fait dans l’alphabet hébreu.
Le romaniste autrichien Julius Subak (1872-1936) ébauche au début du xxe siècle une histoire comparative du judéo-espagnol dans un article, « À propos du judéo-espagnol » (« Zum Judenspanischen », Zeitschrift für romanische Philologie, 1906). L’ethnologue allemand Max Leopold Wagner (1880-1962) publie également des travaux de grammaire sur l’idiome, dont des « Contributions à la connaissance du judéo-espagnol de Constantinople » (« Beiträge zur Kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel », Romanische Dialektstudien, vol. III, 1914). À la même période, le Germano-Britannique Walter Simon (1893-1981) soutient une thèse sur les Caractéristiques du dialecte judéo-espagnol de Salonique (« Charakteristik des judenspanischen Dialekts von Saloniki », Zeitschrift für romanische Philologie, 1920) qui contribue à l’histoire comparative du judéo-espagnol.
Les recherches récentes sur cette langue reprennent avec les travaux de sociolinguistique et de grammaire du linguiste belge Haïm Vidal Séphiha (1923-2019), qui publie notamment la monographie Le judéo-espagnol (1986), ceux de la linguiste française Marie-Christine Varol Bornes (Manuel de judéo-espagnol : langue et culture, 1998), ou encore du linguiste israélien David Monson Bunis (Judezmo : une introduction à la langue des Juifs sépharades de l’Empire ottoman, 1999).
Quelques textes dans la langue judéo-espagnole ont été rassemblés et publiés au début du xxe siècle, par le journaliste Rodolfo Gil y Fernández (1872-1938) – Romancero Judeo-Español, 1911 – et dans la thèse de la britannique Cynthia Mary Crews (1905-1969), Recherches sur le judéo-espagnol dans les pays balkaniques, 1935).
Droit et institutions
La Constitution de 1958 dispose du français comme « langue de la République » (art. 2 modifié en juin 1992), ce qui prescrit l’usage du français dans la sphère publique et comme langue d’enseignement. Inversement, ce recours à des langues minoritaires telles que la langue judéo-espagnole n’est pas exclu de la sphère publique, surtout depuis que l’article 75-1 de la même Constitution leur a reconnu en 2008 une valeur patrimoniale.
En tant que langue régionale, ce sont le Code de l’éducation (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11), le Code de la consommation (L. 121-33) et le Code rural (L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129) qui disposent de l’enseignement du judéo-espagnol. D’un point de vue institutionnel, le judéo-espagnol dispose par ailleurs d’un enseignement au sein de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Sa présence dans la sphère publique et les médias est essentiellement normée par la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Dans certains pays du continent européen, cette langue est également protégée au titre de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires (1992) : en Bosnie-Herzégovine (II, art. 7 et III, art. 8-13).
Au nombre des organismes existants qui promeuvent le judéo-espagnol, sa pratique et son enseignement, on trouve le Centro Sefarad-Israel (Madrid) et l’Autorité nationale du Ladino (Israël).
Raphaël Deuff
Notice synthétique
Noms français : judéo-espagnol, ladino
Nom anglais : Ladino (Dzhudezmo, Haketia, Haketiya, Hakitia, Haquetiya, Jidyo, Judeo Spanish, Judezmo, Judyo, Sefardi, Spanyol)
Statut : langue vivante minoritaire non territoriale
Territoires d’implantation : Espagne des royaumes de Castille et d’Aragon
Système de transcription : alphabet hébreu
Famille linguistique : langues indo-européennes
Typologie linguistique : SVO, syllabique
Notices d’autorité et bibliographiques : ladi1251 (Glottolog.org), lad (ISO 639-3). Parent : sout3200 (Glottolog.org)
Ressources et portails
Portail : Centro Sefarad-Israel (Madrid) (sefarad-israel.es)
Autorité nationale du Ladino (Israël)
Ressource : Ladino – lad (iso639-3.sil.org)
Ressource : Ladino – ladi1251 (glottolog.org)
Ressource : South Castilic – sout3200 (glottolog.org)
Ressource : Judéo-Espagnol (inalco.fr)
Ressource : Les langues juives de diasporas (inalco.fr)
Ressource : OLAC resources in and about the Ladino language (language-archives.org)
Ressources bibliographiques
Bernard Cerquiglini, Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 1er avril 1999. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Christos Clairis, Denis Costaouec et Jean-Baptiste Coyos (dir.), Langues et cultures régionales de France, Paris, L’Harmattan, 2000.
Henri Giordan (dir.), Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, Kimé, 1992. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Henri Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport présenté à Jack Lang, ministre de la Culture, Paris, La Documentation française, 1982. Notice en ligne (catalogue.bnf.fr).
Henri Giordan et al., « Les langues de France », Tribune internationale des langues vivantes, Paris, 2000.
Wolfgang Jenniges (éd.), Select Bibliography on minority languages in the European Union / Bibliographie sélective des langues minoritaires de l’Union européenne, Bruxelles, Bureau européen pour les langues moins répandues, 1997. Notice en ligne (europeansources.info).
Benoît Paumier et al., Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication, 17 juillet 2013. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Jean Sibille, Les Langues régionales, Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000.
Geneviève Vermès (dir.), Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (2 vol.), Paris, L’Harmattan, 1988. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Texte de référence : Constitution du 4 octobre 1958 (legifrance.gouv.fr), art. 2 et 75-1
Enseignement
Texte de référence : Code de l’éducation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11
Texte de référence : Code rural (legifrance.gouv.fr), art. L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129
Texte de référence : Code de la consommation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-33
Médias et sphère publique
Texte de référence : Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (legifrance.gouv.fr), dite « loi Toubon »
Entités nommées fréquentes : Juifs, Code, Ladino, Europe, Paris, Giordan, Les, France, Culture, Constitution.
L’actualité : derniers articles
Actualités culturelles
De Paris à la Corse et des Alpes au Québec : panorama des festivals littéraires d’avril 2025
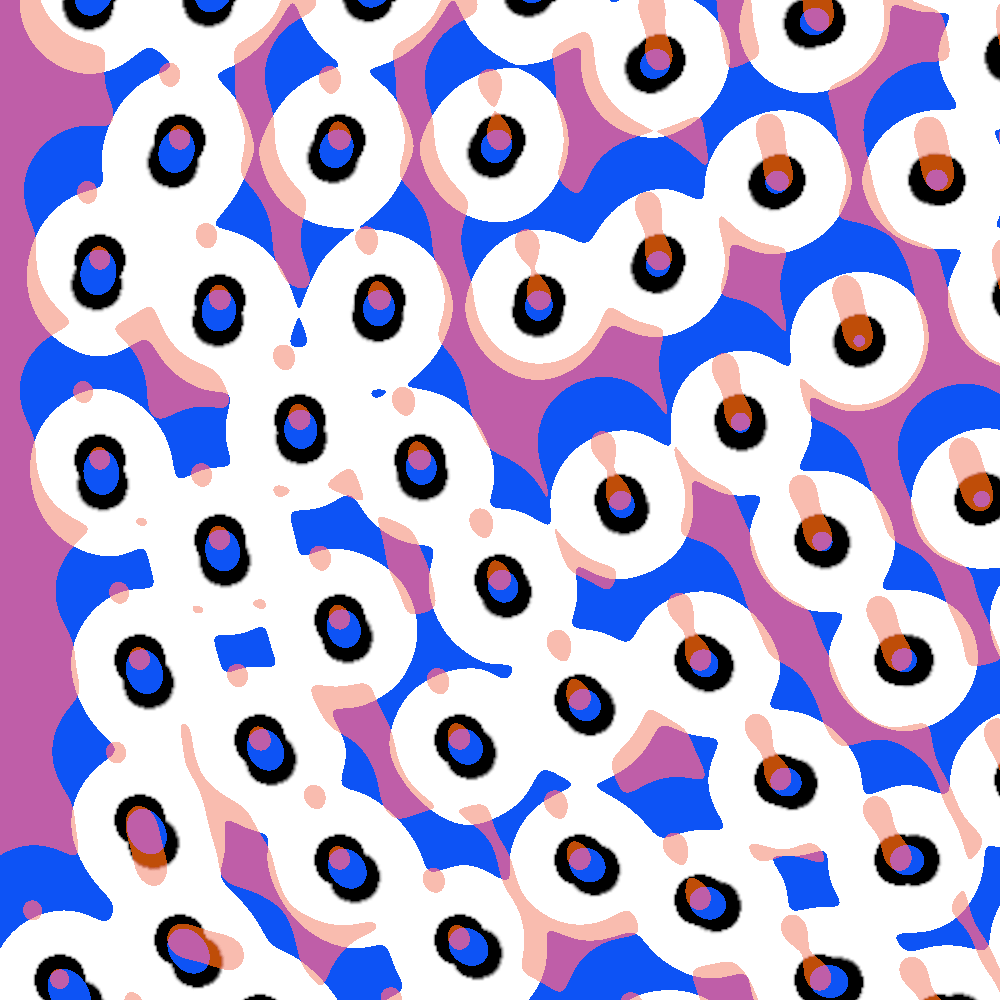
Technologie
Apprentissage statistique

Technologie | Le 3 avril 2025, par Raphaël Deuff.
Technologie
Données ouvertes : OpenAI annonce la publication partielle de l’architecture de son nouveau modèle d’IA

Technologie | Le 2 avril 2025, par Sambuc éditeur.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...