Sciences humaines | Le 30 décembre 2024, par Raphaël Deuff. Temps de lecture : onze minutes.
« Langues de France et d'outre-mer »
Langues kanak
Famille de langues vivantes minoritaires
Les langues kanak (ou kanakes) sont une famille de langues minoritaires des territoires français qui appartiennent aux langues austronésiennes. Elles sont usitées en Nouvelle-Calédonie.

Les langues kanak ou kanakes (la graphie invariable étant préférée aujourd’hui), ou langues néo-calédoniennes, sont une famille de vingt-huit langues minoritaires parlées en Nouvelle-Calédonie. On estime que les langues de ce groupe sont aujourd’hui employées par quelque 70 000 locuteurs, courants ou occasionnels. Ce sont les langues traditionnelles des Kanaks.
Cette famille regroupe les langues suivantes : le caac, le fwâi, le jawe, le nêlêmwa-nixumwak, le nemi, le nyelâyu, le pije, le pwaamèi, le pwapwâ, le yuanga-zuanga et les dialectes de la région de Voh-Koné (langues du groupe Nord), le bwatoo, le haeke, le haveke, le hmwaveke, le vamele (idiomes de la région de Voh-Koné), l’ajië, l’arhâ, l’arhö, le cèmuhî, l’ôrôê, le neku, le paicî, le sîshëë, le tîrî, le xârâcùù et le xârâgurè (langues du groupe Centre), le drubea, le nââ et le numèè (langues du groupe Sud), le drehu, l’iaai et le nengone (langues du groupe Loyauté) ainsi que le fagauvea (langue polynésienne).
Linguistique
Dans la perspective de la classification génétique, les langues kanak se rattachent au groupe océanien de la famille des langues austronésiennes. À l’exception du fagauvea (famille des langues océaniennes centrales et orientales), elles appartiennent toutes au groupe des langues océaniennes du Sud. Ces vingt-huit langues et leurs variations dialectales se sont formées dans la région de la Nouvelle-Calédonie.
Les langues kanak possèdent une structure syntaxique principalement VOS, soit une langue à ordre syntaxique verbe-objet-sujet. Sur le plan de la structure d’actance, les langues kanak sont des langues à la fois ergatives et accusatives.
Littérature des langues kanak
Les langues kanak ne possèdent pas de code écrit propre, ni de tradition littéraire ; même dans le cas de certaines d’entre elles, transcrites après l’arrivée des missions chrétiennes (traductions bibliques et religieuses), elles n’ont pas développé leur propre littérature en dehors du processus d’évangélisation.
La transcription de la langue kanak se fait dans l’alphabet latin.
La linguiste Françoise Ozanne-Rivierre (1941-2007) a recueilli plusieurs œuvres de littérature orale kanak dans ses deux volumes de Textes nemi (Nouvelle-Calédonie) (1979). La linguiste Julia Ogier Guindo est également à l’origine d’une publication scientifique sur certains discours traditionnels, « Le pays invisible. Représentations de la mort dans les discours cérémoniels kanak » (Cahiers de littérature orale, 2011).
Parmi les premiers auteurs a avoir décrit les langues de Nouvelle-Calédonie, on peut noter l’astronome et militaire Élisabeth-Paul-Édouard de Rossel (1765-1829), à qui l’on doit un chapitre sur le « Vocabulaire de la langue des habitans de la Nouvelle-Calédonie » (Voyage de D’Entrecasteaux envoyé à la recherche de La Pérouse, 1808, t. I, p. 573-584), ainsi que le linguiste anglais Sidney Herbert Ray (1858-1939), qui a produit entre la fin du xixe siècle et la première moitié du xxe siècle plusieurs ouvrages et opuscules sur les langues mélanésiennes, dont l’article général « The Polynesian Languages in Melanesia » (Anthropos, 1919).
Dans la littérature scientifique contemporaine, la linguiste Françoise Ozanne-Rivierre (1941-2007) est l’auteure de contributions sur le nââ (Haudricourt et al., Les langues mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie, 1979, p. 72-79), le cèmuhî (idem, p. 47-52), le fwâi (idem, p. 31-37), le paicî (idem, p. 53-57), le pije (idem, p. 38-44), ainsi que d’un Dictionnaire paicî-français, suivi d’un lexique français-paicî (1983). Le linguiste néo-zélandais Darrell Trevor Tryon (1942-2013) a publié des monographies ou des articles sur les trois langues kanak de l’île Loyauté, le drehu (Dehu grammar, 1968), l’iaai (Iai Grammar, 1968) et le nengone (« Nengone », Comparative Austronesian dictionary, 1995). On peut aussi mentionner des contributions concernant la langue numèè (Sophie Rendina, Description of Numee, 2009), le vamele (Jean Rohleder, A Grammar of Vamale: A language of New Caledonia, 2021) et le ‘ôrôê (Tsuji Emiko, « ‘Ôrôê », Grammatical Sketches from the Field, 2014).
Droit et institutions
Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l’État un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.
Les langues kanak sont reconnues comme langues d’enseignement et de culture.
Loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, art. 215.
Sur les territoires français, la Constitution de 1958 dispose : « La langue de la République est le français. » (art. 2 modifié en juin 1992), ce qui prescrit l’utilisation du français dans la sphère publique et comme langue d’enseignement. Néanmoins, l’emploi dans l’espace public de langues régionales ou minoritaires n’est pas proscrit, notamment depuis que l’article 75-1 de la Constitution (loi constitutionnelle de 2008) leur reconnaît une valeur comme patrimoine immatériel.
L’enseignement des langues kanak est actuellement l’objet d’une législation grâce à la loi organique du 19 mars 1999, qui donne notamment compétence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour établir les programmes de l’enseignement primaire et secondaire, spécialement pour l’enseignement des langues autres que le français. Par ailleurs, depuis 1992, un dispositif réglementaire spécifique (application de la loi Deixonne à la Nouvelle-Calédonie) permettait aux langues kanak d’être enseignées dans le primaire et le secondaire et de faire l’objet d’une épreuve facultative au baccalauréat. Dans le supérieur, les langues kanak sont aussi enseignées au sein de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Leur emploi dans les médias et la sphère publique est essentiellement réglementé par le décret 89-524 de 27 juillet 1989 relatif à l’Agence de développement de la culture canaque.
L’Académie des langues kanak est la principale organisation promouvant les langues kanak, leur pratique et leur enseignement actuellement.
Raphaël Deuff
Notice synthétique
Noms français : langues kanak, langues néo-calédoniennes
Nom anglais : New Caledonian
Statut : famille de langues vivantes minoritaires
Territoires d’implantation : Nouvelle-Calédonie
Système de transcription : alphabet latin (transcription)
Famille linguistique : langues austronésiennes
Typologie linguistique : VOS/SVO, ergative/accusative
Notices d’autorité et bibliographiques : newc1243 (Glottolog.org). Parent : sout3173 (Glottolog.org)
Localisation géographique
Ressources bibliographiques et portails
Portail : Académie des langues kanak (alk.nc)
Ressource : New Caledonian – newc1243 (glottolog.org)
Ressource : Southern Melanesian – sout3173 (glottolog.org)
Ressource : Drehu (Lifou) (inalco.fr)
Ressources bibliographiques
Bernard Cerquiglini, Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 1er avril 1999. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Christos Clairis, Denis Costaouec et Jean-Baptiste Coyos (dir.), Langues et cultures régionales de France, Paris, L’Harmattan, 2000.
Henri Giordan (dir.), Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, Kimé, 1992. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Henri Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport présenté à Jack Lang, ministre de la Culture, Paris, La Documentation française, 1982. Notice en ligne (catalogue.bnf.fr).
Henri Giordan et al., « Les langues de France », Tribune internationale des langues vivantes, Paris, 2000.
Wolfgang Jenniges (éd.), Select Bibliography on minority languages in the European Union / Bibliographie sélective des langues minoritaires de l’Union européenne, Bruxelles, Bureau européen pour les langues moins répandues, 1997. Notice en ligne (europeansources.info).
Benoît Paumier et al., Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication, 17 juillet 2013. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Jean Sibille, Les Langues régionales, Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000.
Geneviève Vermès (dir.), Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (2 vol.), Paris, L’Harmattan, 1988. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Texte de référence : Constitution du 4 octobre 1958 (legifrance.gouv.fr), art. 2 et 75-1
Enseignement
Texte de référence : Code de l’éducation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11, ainsi que L. 257-1
Texte de référence : Code rural (legifrance.gouv.fr), art. L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129
Texte de référence : Code de la consommation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-33
Texte de référence : Loi no 99-209 organique du 19 mars 1999 (legifrance.gouv.fr), art. 140, 2015
Médias et sphère publique
Texte de référence : Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (legifrance.gouv.fr), dite « loi Toubon »
Texte de référence : Décret 89-524 de 27 juillet 1989 relatif à l’Agence de développement de la culture canaque (legifrance.gouv.fr)
Entités nommées fréquentes : Nouvelle-Calédonie, Paris, Giordan, Les, Culture, France, Constitution, Code.
L’actualité : derniers articles
Droit
Le Sénat adopte l’introduction du concept de contrôle coercitif dans le code pénal

Actualités culturelles
De Paris à la Corse et des Alpes au Québec : panorama des festivals littéraires d’avril 2025
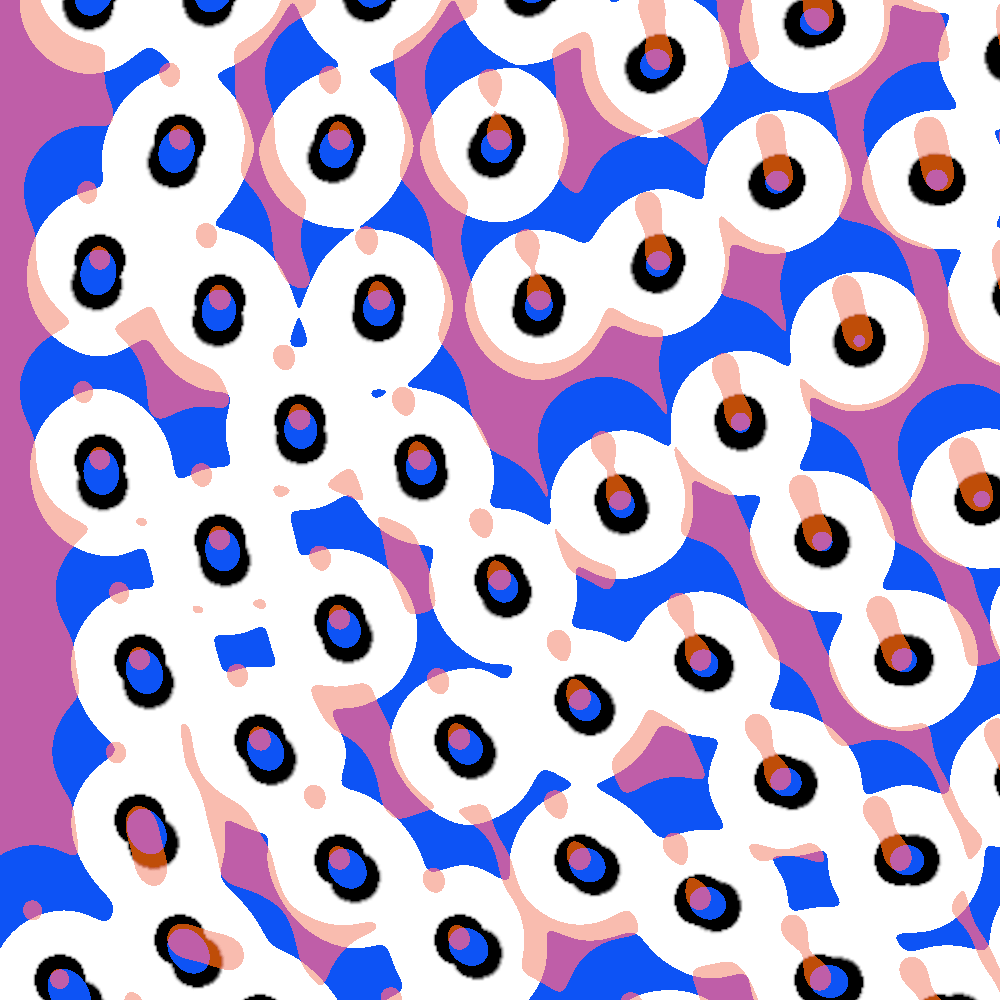
Technologie
Apprentissage statistique

Technologie | Le 3 avril 2025, par Raphaël Deuff.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...